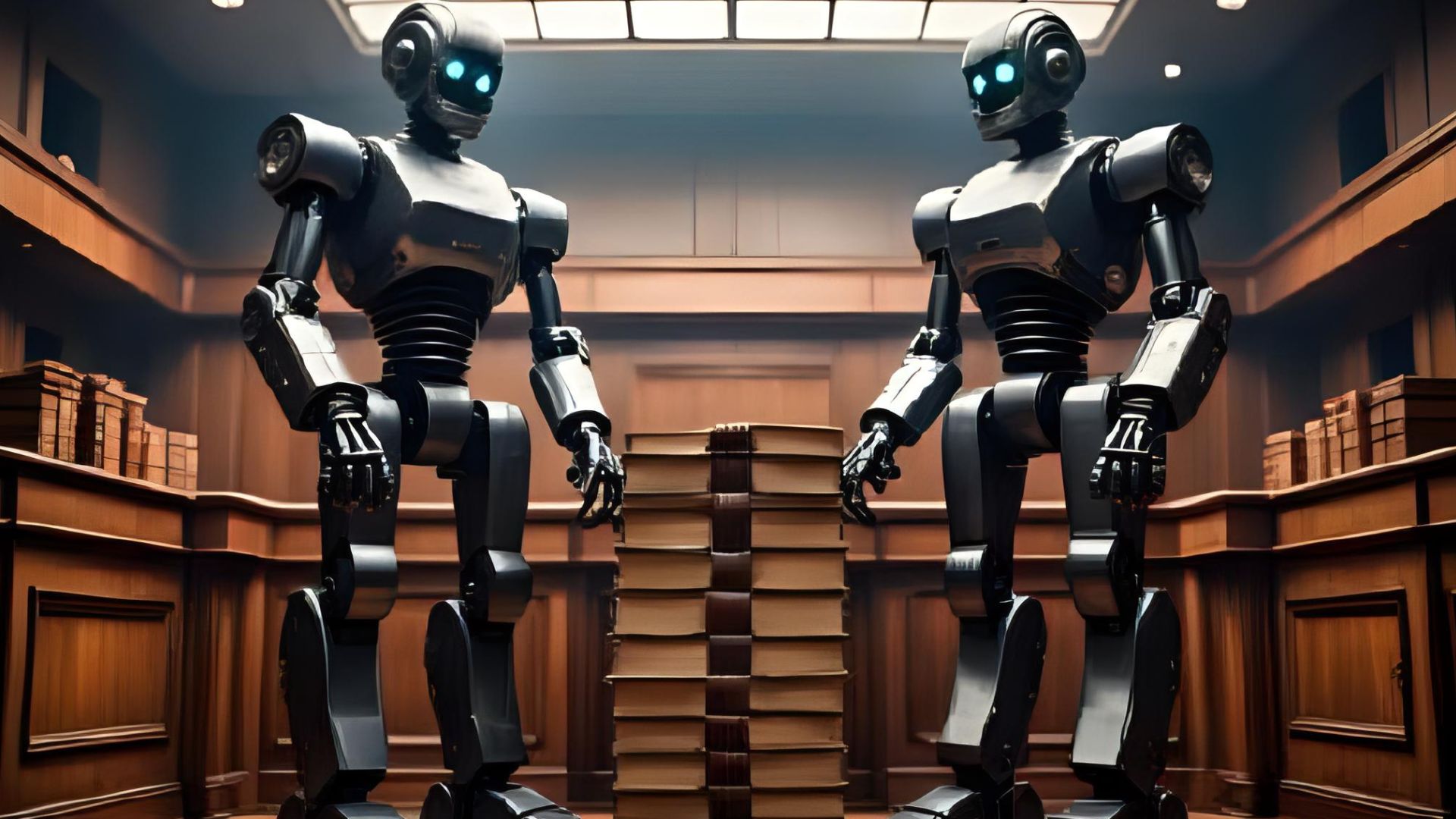Spotify est au cœur d’une nouvelle controverse après la diffusion de titres musicaux générés par intelligence artificielle, imitant la voix et le style d’artistes disparus. Si la technologie progresse à une vitesse fulgurante, cette pratique interroge l’industrie musicale, les auditeurs… et les ayants droit.
Parmi les morceaux en question : des “nouvelles chansons” de Freddie Mercury, Kurt Cobain ou encore Amy Winehouse, tous décédés depuis plus d’une décennie. Ces titres ne sont pas des remix ni des hommages traditionnels, mais bien des créations entièrement produites par IA, vocalement et musicalement, à partir de modèles ayant appris à imiter leurs timbres, intonations et structures mélodiques.
Spotify n’est pas accusée de produire elle-même ces contenus, mais de les héberger et de les rendre disponibles à ses millions d’utilisateurs, comme n’importe quelle autre chanson. Des artistes, fans et organisations de défense du droit d’auteur s’insurgent contre cette situation, la qualifiant de “profanation numérique”. Le débat est d’autant plus vif que ces œuvres n’ont pas été validées par les ayants droit ou les familles des artistes concernés.
Selon PointGPhone, certains morceaux sont présentés comme de vraies chansons inédites d’artistes disparus, renforçant l’ambiguïté. L’écoute est certes fascinante par la prouesse technique, mais aussi dérangeante : les IA ne se contentent plus de reproduire une voix, elles ressuscitent une présence artistique dans des compositions entièrement fabriquées.
Cette pratique pose plusieurs problèmes : d’une part, elle joue sur l’émotion du public, qui croit retrouver des idoles perdues. D’autre part, elle crée un précédent juridique incertain sur l’utilisation post-mortem de l’image vocale et du style d’un artiste. En l’absence de législation claire sur les droits de la personnalité dans le contexte de l’intelligence artificielle, la plateforme se retrouve à héberger des contenus juridiquement flous mais hautement viraux.
Spotify s’est déjà retrouvée au centre de polémiques liées à l’IA, notamment lors de la mise en ligne de morceaux où des IA imitaient des stars vivantes comme Drake ou The Weeknd. Mais cette fois, la controverse est d’autant plus sensible qu’elle concerne des personnalités décédées, incapables de se défendre ou de donner leur accord.
Si certains considèrent cela comme une forme d’hommage, d’autres y voient une instrumentalisation purement commerciale, sans respect pour l’œuvre originale ni pour la personne. Une ligne rouge est franchie lorsque la voix d’un artiste est exploitée à des fins de divertissement, sans consentement et sans cadre juridique clair.
Ce phénomène illustre les tensions actuelles entre innovation et régulation. Les plateformes de streaming comme Spotify, YouTube ou Apple Music deviennent malgré elles des terrains d’expérimentation sauvage pour des contenus générés par l’IA. Faute de cadre précis, elles naviguent entre fascination pour la nouveauté et risque réputationnel croissant.
Pour faire face à cette problématique, les acteurs de la musique devront réfléchir à de nouveaux modèles de droits posthumes et à la reconnaissance d’une “empreinte artistique numérique” protégée au même titre que les œuvres enregistrées. Il en va non seulement de la dignité des artistes disparus, mais aussi de la crédibilité des plateformes.
Le public, de son côté, semble partagé. Si la curiosité est indéniable, beaucoup d’auditeurs dénoncent l’absence d’éthique et de transparence. Savoir si une chanson est chantée par un humain ou une IA, si elle est une œuvre autorisée ou une imitation, devient une information essentielle. Une nouvelle responsabilité pour les plateformes de streaming, sommées de clarifier ce qu’elles diffusent et sous quelles conditions.